Edito et présentation des invités
Timothée : Imaginez enfiler votre jean préféré, d’un bleu profond parfait… sans savoir que derrière cette couleur se cache une empreinte carbone massive. La teinture est même le deuxième poste d’émissions d’un vêtement, juste après la fabrication de la fibre et ça, on l’ignorait totalement.
C’est là qu’intervient Pili, une start-up française qui a décidé de réinventer l’histoire de la couleur. Leur secret ? Des bactéries et des levures capables, en se nourrissant de sucre issu de la biomasse, de produire naturellement des molécules colorantes. Les mêmes que celles dérivées du pétrole… mais sans pétrole. Résultat : un impact carbone divisé par deux, des teintes tout aussi éclatantes et une tenue irréprochable. De quoi convaincre des marques comme Citizens of Humanity, qui utilisent désormais les colorants Pili pour teindre leurs jeans.
Et demain ? Encres, peintures, textile… autant d’industries prêtes à changer de fournisseurs pour décarboner leur chaîne de production. Qui l’eût cru ?
Dans cet épisode, on va chercher à comprendre comment réduire l’impact des colorants et pigments que l’on retrouve dans presque tous les objets du quotidien. Et pour en parler, j’ai le plaisir d’accueillir Guillaume Boissonnat-Wu, directeur général de Pili.
À ses côtés, pour la seconde fois dans Qui l’eût cru, celle qui met de la couleur dans ses diagnostics ACV jamais un mot de trop notre experte en éco-conception, Sybille Martin.
Parcours et fonctionnement de la solution
Timothée : Guillaume, bienvenue. On va parler d’un sujet qui, pour moi, était totalement inconnu. J’ai été impressionné choqué, même quand j’ai découvert que la teinture était le deuxième poste d’émissions de CO₂ dans la fabrication d’un jean. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse du projet ?Comment en es-tu arrivé à faire produire des colorants à des bactéries nourries au sucre ?
Guillaume : Merci beaucoup. Pili est d’abord un projet entrepreneurial né dans un espace de recherche collaboratif appelé La Paillasse. C’était un lieu où chercheurs, entrepreneurs et designers travaillaient autour d’une même technologie : la biologie synthétique. Cette discipline permet à des micro-organismes de produire des molécules grâce aux connaissances acquises sur les procédés de fermentation. Certains de ces procédés sont très anciens comme ceux utilisés pour fabriquer la bière ou le pain mais les technologies actuelles nous permettent aujourd’hui de faire produire une grande variété de molécules à des bactéries et à des levures.
Après mes études en chimie, je me suis intéressé à un projet né à La Paillasse : le projet Pili, qui consistait à produire de la couleur à partir de micro-organismes. Très vite, nous avons constaté l’intérêt d’industriels, notamment dans l’encre et le textile. Cela nous a poussés, avec mes associés, à créer une entreprise pour développer cette solution à l’échelle industrielle, des colorants renouvelables produits par des micro-organismes.
Timothée : On est en quelle année ?
Guillaume : À ce moment-là, on est en 2015.
Timothée : On est en 2015, mais en fait, pourquoi vous êtes arrivés sur le colorant ? Parce que vous aurez pu arriver sur plein d’autres, j’imagine, sujets de chimie.
Guillaume : Tout à fait. Au départ, il s’agissait d’un atelier pédagogique pour enfants, qui marque vraiment les débuts du projet Pili. L’idée était de permettre aux enfants puis aux adultes, car l’atelier s’est rapidement ouvert à tous d’entrer en contact avec le vivant de manière plus positive que ce à quoi on est habitué.
En France, le pays de Pasteur, les bactéries ont souvent une image négative. Montrer qu’elles composent notre microbiote, qu’on commence à mieux connaître aujourd’hui, et qu’elles peuvent aussi contribuer à décarboner les processus de la chimie industrielle, était important pour les personnes impliquées dans ce projet et, plus largement, pour l’esprit de La Paillasse.
Cet atelier, qui s’appelait Pousse ton encre, invitait les enfants à dessiner avec des bactéries. Ils faisaient pousser des micro-organismes qui produisaient des couleurs bleu, jaune, rouge et pouvaient ainsi créer des illustrations, notamment des « super-héros bactériens », que les enfants adoraient.
Timothée : Si on revient du coup un petit peu sur aujourd’hui. Le fonctionnement de Pili, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le process industriel qu’il y a derrière, peut-être une anecdote dans le développement pour produire à la fin un colorant ?

Guillaume : Oui, tout à fait. Aujourd’hui, Pili est une entreprise d’une quarantaine de personnes. On y trouve beaucoup de chercheurs, mais aussi de plus en plus de spécialistes du développement de procédés industriels un métier un peu différent ainsi que des équipes chargées de faire tourner l’entreprise et de mettre nos colorants sur le marché.
Un procédé de fermentation repose d’abord sur un micro-organisme que nous avons conçu et « entraîné » dans notre laboratoire. On commence par le nourrir avec une source de carbone, généralement un dérivé de sucre : cela peut venir de l’amidon, de la betterave, mais aussi de déchets de bois ou de papier. Le micro-organisme consomme ce sucre, produit une nouvelle molécule à partir de celui-ci, se reproduit et génère son énergie.
Cette fermentation se déroule dans de grandes cuves pouvant contenir plusieurs dizaines de milliers de litres. À la fin du processus qui dure de deux jours à une semaine on récupère ce qu’on appelle un« mou de fermentation », qui contient la molécule recherchée.
Vient ensuite l’étape de génie chimique : on purifie cette molécule jusqu’au niveau souhaité. À partir d’elle, on peut produire des colorants jaunes, rouges ou bleus pour le textile, ainsi que des pigments destinés aux encres ou aux peintures. C’est la partie formulation de nos colorants et pigments.
Une fois ces molécules prêtes, nous les vendons à des industriels qui les utilisent pour colorer les produits du quotidien.
Timothée : Je ne suis pas du tout chimiste, et tu m’as un peu perdu à un moment. Dans mon esprit, la bactérie produit directement la couleur par exemple le jaune mais ce n’est pas exactement ça. Elle fabrique plutôt une molécule, un élément de base. Alors comment transforme-t-on cette molécule en la couleur finale que vous voulez obtenir ?
Et si je ne me trompe pas, aujourd’hui, vous travaillez principalement sur le bleu… l’indigo, c’est bien ça ?
Guillaume : L’indigo, c’est effectivement le bleu utilisé pour le denim. Tout à fait. En réalité, nous avons deux types de procédés.
D’un côté, la fermentation : nous avons découvert qu’il était plus efficace de produire en très grands volumes une molécule intermédiaire, puis de la transformer en une variété de colorants différents, plutôt que de développer une bactérie spécifique pour chaque molécule.
De l’autre côté, certaines molécules sont soit naturelles, soit directement produisibles par des micro-organismes. Dans ce cas, lorsque toute la production peut se faire dans la bactérie, c’est plus simple, plus écologique et nous privilégions cette voie dès que c’est possible.
Timothée : Donc en fonction de la bactérie, elle produit parfois directement la couleur que vous voulez.
Guillaume : Exactement.
Timothée : Et ça, par rapport à un colorant pétro-sourcé, quels sont les impacts que vous avez réussi à réduire ?Parce qu’il faut quand même pas mal d’énergie pour produire tout ça, donc est-ce qu’on s’y retrouve vraiment ?
Guillaume : Oui, on s’y retrouve pour deux raisons principales. La première, c’est qu’au lieu d’utiliser du carbone enfoui donc du pétrole on utilise du carbone issu du CO₂, capté par les plantes et transformé en sucre grâce à la photosynthèse. Comme ce carbone est biosourcé, l’impact CO₂ est nettement plus faible. C’est encore plus vrai lorsqu’on utilise des déchets: au lieu d’être détruits, ils sont valorisés pour produire nos molécules.
La deuxième raison, c’est que la synthèse chimique classique en particulier la chimie de commodité nécessite souvent énormément d’énergie : hautes températures, réactions en phase gaz à 350 °C, etc. La fermentation, elle, se déroule entre 30 et 35 °C, dans l’eau, et demande donc bien moins d’énergie.
Cette combinaison carbone renouvelable et les procédés peu énergivores nous permet d’obtenir des colorants dont l’impact CO₂ est réduit jusqu’à 50% par rapport à un colorant pétro-sourcé. Et sur le produit textile final, notamment pour les jeans, cela représente déjà une baisse de 5 à 10% de l’empreinte carbone totale.
{{cta-1}}
Capsule Expert #1
Timothée : On parlait d’impact CO₂, je vais repasser la parole à Sibylle, experte ACV chez R3. On voulait justement prendre un peu de recul pour comprendre ce qu’est l’impact environnemental au sens large, notamment dans le textile et particulièrement pour le jean, afin d’expliquer quel est le point de départ aujourd’hui dans ce secteur.
Sibylle : Oui, tout à fait. Prenons l’exemple du secteur textile, qui est l’une des principales applications. Pour rappeler quelques ordres de grandeur : le textile a évidemment un impact important sur le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, mais il génère aussi de nombreux autres impacts environnementaux.
C’est, par exemple, la troisième source mondiale de dégradation de l’eau et d’utilisation des terres, notamment à cause de la culture des fibres naturelles. Le secteur est également responsable de 20% de la pollution de l’eau potable, en grande partie à cause des étapes de teinture et d’ennoblissement dans le cycle de vie d’un textile.
Pendant l’usage, chaque lavage de vêtements surtout s’ils contiennent des fibres synthétiques comme le polyester peut relâcher jusqu’à 700 000 microfibres dans l’environnement. Et en fin de vie, seulement 1% des vêtements sont aujourd’hui recyclés : un enjeu majeur pour la durabilité.
C’est justement pour inverser cette tendance que l’Union européenne a lancé en 2022 une stratégie textile durable, avec de nouvelles exigences d’éco-conception, la création d’un passeport produit numérique, et des incitations à l’innovation pour prolonger la durée de vie, réparer, réutiliser, recycler et réduire l’impact de la fabrication.
Si l’on se concentre sur l’analyse de cycle de vie (ACV) du jean, on étudie toutes les étapes : culture du coton, filature, teinture, tissage, assemblage, utilisation et fin de vie. Au total, la production et l’usage d’un jean sur cinq ans représentent environ 25 kg de CO₂ équivalent lavages compris. Cela correspond à peu près aux émissions de trois repas à base de bœuf.
« Mais l’ACV ne se limite pas au climat, elle prend aussi en compte d’autres indicateurs comme l’usage de l’eau, la toxicité ou encore la pollution des sols et des milieux aquatiques. »
Timothée : Dans les étapes les plus importantes, tu l’as un petit peu dit, mais on les retrouve du coup, c’est quoi la culture des fibres et la teinture ?
Sibylle : Oui, exactement. Comme vous l’avez déjà évoqué, la première étape la plus impactante est la culture des fibres, en particulier celle du coton, qui demande beaucoup d’eau, d’intrantset de terres. Pour les fibres synthétiques, s’ajoute la problématique des microplastiques relâchés lors du lavage.
La deuxième étape clé est celle de la teinture et de l’ennoblissement. La teinte bleue du denim l’indigo est aujourd’hui majoritairement produite à partir de composés de synthèse contenant notamment du chlore et des métaux lourds. Au-delà de l’impact énergétique et des émissions de gaz à effet de serre, comme le disait Guillaume, ces procédés génèrent d’importants rejets dans l’eau, souvent peu ou pas traités.
Les personnes travaillant dans la filière agriculteurs, agricultrices et opérateurs sont directement exposées à ces produits, qui peuvent pénétrer les voies respiratoires, contaminer les sols, les rivières et les nappes phréatiques.
Faciliter le passage à l’action
Timothée : Guillaume, peut-être une réaction ou un complément par rapport aux calculs multicritères que vous avez sans doute réalisés ? Au-delà du CO₂ dont tu as parlé, y a-t-il d’autres éléments que tu souhaiterais porter à la connaissance de nos auditeurs ?

Guillaume : Oui, il y en a plusieurs. L’un des points les plus importants et que nous mettons souvent en avant concerne spécifiquement l’indigo. Il faut comprendre que chaque procédé de fabrication d’un colorant est très différent : il est donc difficile de réaliser des ACV globales et représentatives pour l’ensemble des colorants et pigments. À moins de faire mille ACV pour les mille références commerciales… ce qui n’aurait plus vraiment de sens. C’est pourquoi nous parlons beaucoup de l’indigo, que nous connaissons très bien.
Pour expliquer brièvement la « recette » de fabrication de l’indigo pétrochimique : on part d’une molécule cancérogène, l’aniline, que l’on mélange à du formaldéhyde et du cyanure. On chauffe ensuite l’ensemble à très haute température en présence de sodium fondu, puis on jette ce mélange dans l’eau, ce qui fait précipiter l’indigo. On se retrouve donc avec un cocktail de substances toxiques et cancérigènes.
Il serait illusoire de penser qu’un tel procédé n’a pas d’impact notamment sur l’eau. D’ailleurs, dans l’indigo pétro chimique commercialisé aujourd’hui, on retrouve des résidus des produits de départ. Lorsqu’on purifie une molécule, les principales impuretés proviennent justement des réactifs non consommés.
On observe ainsi dans l’indigo classique des taux non négligeables d’aniline, qui se retrouvent ensuite dans les effluents de teinture rejetés dans les pays producteurs.
L’intérêt de l’indigo produit par Pili, c’est que nous n’utilisons aucune de ces matières premières toxiques : pas d’aniline, pas de réactifs cancérigènes. Par conséquent, on ne retrouve pas ces substances dans notre indigo, ni comme impuretés.
Les seules impuretés présentes proviennent du procédé de fermentation, donc de composés d’origine biologique, bien plus compatibles avec le vivant.
Timothée : En t’écoutant, je me demande: pourquoi continue-t-on encore à produire des colorants avec toutes ces substances toxiques ? Peut-être que les industriels ne le savent pas, ou qu’ils ne connaissent pas encore votre solution… Ou peut-être que c’est simplement très compliqué à intégrer dans un processus de production existant.
Justement, j’aimerais que tu nous parles un peu plus de votre collaboration avec Citizens of Humanity. Comment ont-ils réussi à remplacer leur colorant traditionnel par votre bleu indigo ?
Guillaume : En réalité, c’est relativement simple, car notre stratégie chez Pili a toujours été de ne pas imposer de changements aux producteurs textiles dans leur processus de fabrication. Notre objectif a toujours été de produire la même molécule, mais biosourcée et avec un impact carbone réduit.
Concrètement, cela permet au teinturier qui achète aujourd’hui son indigo à un fournisseur classique de simplement remplacer cet indigo par celui de Pili, sans rien changer à son process.
Quand je dis « normalement », c’est parce que dans un procédé industriel, changer de fournisseur est toujours une grosse affaire. Quand un process fonctionne, on évite d’y toucher la priorité, c’est la qualité, la répétabilité, et la capacité à produire toujours la même chose avec les mêmes spécifications.
« Il y a donc quelque chose d’inévitable dans l’adoption de nouveaux matériaux par l’industrie : les phases de qualification sont longues. Elles peuvent durer 6, 12, parfois 18 mois. »
Et aujourd’hui, c’est exactement la phase dans laquelle nous nous trouvons avec de nombreux clients.
Timothée : Mais du coup quel a été le déclic là ? Si on essaye même nous chez nous, dans nos clients, de se dire attends mais qu’est-ce qui a fait qu’à un moment donné cette entreprise a pris le risque de changer business à Juhol, ça marchait très bien, et de passer par vous.
Guillaume : Je pense que la particularité de Citizens of Humanity, c’est qu’ils sont engagés sur la soutenabilité depuis longtemps. La collection que nous développons avec eux autour de l’éco-indigo utilise notamment du coton régénératif. Comme tu l’as rappelé tout à l’heure, Sybille, le premier enjeu d’un article textile, c’est la fibre, puisque c’est elle qui représente la majeure partie de son impact.
Les entreprises qui ont déjà fait ce travail sur le coton régénératif se tournent logiquement vers l’étape suivante, les procédés d’ennoblissement, donc la teinture, et donc l’indigo. C’est, je pense, l’une des principales raisons qui ont poussé Citizens of Humanity à collaborer avec nous. Ayant déjà avancé sur le coton, ils cherchaient la prochaine étape.

Timothée : Et en termes de prix sur le marché, vous vous positionnez comment ? On parle pas mal aussi de relocalisation de la filière textile en France. Est-ce que pour une PME française, on pourrait utiliser votre colorant ?
Guillaume : Oui, c’est tout à fait possible. Sur un article textile, le surcoût est de l’ordre de 1 à 2 dollars par jean. Ce n’est pas compatible avec tous les segments de marché : dans le mass market, où les prix sont très bas, ce serait difficilement absorbable. En revanche, sur des produits premiums destinés à des clients sensibles aux enjeux de soutenabilité, il y a une vraie proposition de valeur à passer à l’indigo Pili, un indigo biosourcé.
Nous pensons d’ailleurs que c’est le nouveau standard de la teinture indigo : ne plus utiliser d’indigo pétro-sourcé, mais de l’indigo Pili.
Évidemment, aujourd’hui, nous avons une production encore limitée, réalisée en sous-traitance, et notre procédé n’a que trois ans. À l’inverse, l’indigo pétrochimique provient d’usines qui produisent 50 000tonnes par an, avec un procédé développé depuis 150 ans, l’un des premiers de l’industrie chimique moderne.
Il est donc normal que nous soyons actuellement plus chers. Avec les effets d’échelle et l’apprentissage industriel, nous nous rapprocherons progressivement du coût de l’indigo pétrochimique. D’ailleurs, rien ne justifie structurellement un prix plus élevé : le sucre n’est pas plus cher que le benzène ou l’aniline.
Timothée : Et mon jean il sera aussi joli avec autant de lavage en utilisant votre encre, il ne va pas se dissoudre au bout de 3 lavages en machine ?
Guillaume : Non, on a passé beaucoup de temps à vérifier les performances de notre indigo. L’avantage, c’est que l’industrie textile est très normée : dès qu’on y entre, on vous fournit la liste de tous les tests ISO à effectuer pour vérifier la tenue à la lumière, au lavage, au repassage, à la transpiration… Il existe une multitude de tests pour s’assurer de la solidité des colorants.
Notre indigo affiche exactement les mêmes performances que l’indigo conventionnel. Et pour ce qui est de la couleur, vous pouvez déjà aller voir sur le site de Citizens of Humanity. Ils viennent de lancer la collection homme, après avoir commencé par la collection femme, celle qui se vendait le plus dans cette catégorie de produits. Aujourd’hui, tous les articles sont disponibles à la vente.
Si vous passez dans les bureaux de Pili, on a d’ailleurs toutes les pièces exposées sur des portants : des jeans, des vestes, des sacs…Toute une gamme en denim.
Capsule Expert #2
Timothée : Je voulais repasser la parole à Sibylle, tu voulais nous faire une petite plongée dans le monde fabuleux de l’industrie chimique européenne. On parle beaucoup de la capacité de l’UE à maîtriser sa production, son approvisionnement en produits chimiques stratégiques. Et aujourd’hui, comment ça peut impacter le secteur de la chimie ?
Sibylle : Effectivement, c’est au cœur de la souveraineté industrielle, produire localement, durablement, à coûts maîtrisés et sans dépenses excessives. La Commission européenne a d’ailleurs présenté cet été un plan récent visant à renforcer l’industrie chimique, en soutenant l’innovation, en simplifiant les règles et en luttant contre la concurrence déloyale. Pour y parvenir, plusieurs leviers existent. D’abord, le règlement REACH impose déjà des normes strictes sur les substances chimiques, ce qui pousse les industriels à substituer les substances à risque et à investir dans des alternatives plus sûres, une dynamique renforcée par les stratégies RSE et la CSRD des grands groupes européens. Ensuite, la taxe anti-dumping permet à l’Union européenne de réagir lorsque des prix artificiellement bas faussent le marché ; elle peut imposer des droits supplémentaires, comme cela a été fait récemment pour la mélamine originaire de Chine. Enfin, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, le MACF, imposera à partir de 2026 aux importateurs de payer un coût carbone pour les produits fortement émetteurs, notamment dans l’acier, le ciment et la chimie. Les produits très carbonés perdront ainsi leur avantage prix, ce qui renforcer à l’intérêt d’acheter au sein de l’Union européenne et de se tourner vers des solutions bas carbones, comme celles proposées par Pili.
Timothée : Ça va changer quoi pour une PME justement ?
Sibylle : Cela va changer plusieurs choses, et si l’on reste dans les aspects chiffrés, on peut en retenir trois principales. D’abord, il faudra anticiper et se conformer. Si vous importez des produits chimiques, vous devrez prouver leur conformité, demander à vos fournisseurs des fiches de sécurité à jour et vérifier la présence de substances préoccupantes que l’Union européenne prévoit de restreindre progressivement. Cela concerne, par exemple, les PFAS dont on a beaucoup entendu parler récemment pour les traitements déperlants, ou encore les phtalates que l’on retrouve dans les encres textiles. Si votre produit dépasse certains seuils, vous devez le savoir et idéalement prévoir une alternative.
Ensuite, ces nouvelles règles peuvent aussi devenir une source d’opportunités. Si vous développez des produits biosourcés, cela peut vous permettre de gagner en compétitivité et de vous inscrire dans la tendance actuelle. Et si vous ne développez pas de produits chimiques mais que vous en importez, les remplacer par des alternatives locales, conformes aux réglementations et moins carbonées, vous aidera à sécuriser vos approvisionnements, à réduire votre exposition réglementaire et à miser sur l’innovation.
"En résumé, la chimie européenne se verdit et se protège. Pour les PME, c’est donc le moment d’investir dans l’innovation et la conformité, plutôt que de subir les sanctions de demain."
On s’engage !
Timothée : Peut-être une réaction, Guillaume, en termes de perspective pour vous ?J’imagine que ça va dans le bon sens. Est-ce que vous voyez déjà des résultats sur la suite ?

Guillaume : Des résultats, non, je pense que c’est encore un peu tôt pour en parler. En revanche, ce que nous observons très clairement, c’est que l’industrie chimique européenne et française en particulier reste fragile, car elle est soumise à une forte concurrence internationale. Nous sommes installés sur une plateforme chimique qui regroupe plusieurs entreprises, ce qui nous permet d’être au contact direct des industriels et d’échanger quotidiennement avec eux. La concurrence internationale fait partie du jeu dès lors qu’on est exposé au marché mondial, mais le fait d’avoir des règles de concurrence plus équitables entre pays nous semble être une bonne chose.
Un exemple très concret concerne le règlement REACH. Lorsqu’on produit plus d’une tonne d’une molécule, on doit obligatoirement l’enregistrer et déclarer les risques qui lui sont associés : présence éventuelle de composés cancérigènes, dangers pour la santé, etc. Quand nous avons commencé à produire de l’indigo, nous nous sommes donc enregistrés, comme l’exige la loi, et nous avons consulté les pictogrammes de danger associés à l'indigo conventionnel. Parmi eux figurait le pictogramme « cancérogène », lié à la présence d’aniline résiduelle, une molécule cancérigène issue du procédé pétrochimique.
Comme notre indigo n’est pas contaminé par de l’aniline, nous avons pu supprimer ce pictogramme. C’est un très bon exemple de la manière dont une réglementation européenne peut devenir un avantage compétitif direct :nous proposons le même indigo, mais sans aniline, ce qui nous permet d’éliminer le pictogramme de cancérogénicité et de nous différencier très clairement du produit conventionnel.
Timothée : Tu parles beaucoup d’indigo, c’est quoi un peu les produits que tu aimerais développer dans l’avenir du coup ?
Guillaume : Aujourd’hui, nous avons beaucoup de projets en développement, mais celui qui arrive le plus vite, c’est la mise à disposition d’une trichromie destinée aux industries des peintures, des encres et des polymères.
Il faut savoir que ces trois secteurs utilisent des pigments dans une multitude d’applications : les peintures automobiles ou murales, les encres des imprimantes ou celles présentes sur tous les emballages du quotidien, et les polymères qui servent à colorer dans la masse de nombreux matériaux que l’on utilise tous les jours.
Contrairement aux colorants, qui sont solubles dans l’eau, les pigments ne le sont pas. Ils sont dispersés dans une laque ou une résine, puis appliqués sur les surfaces ou incorporés directement dans la matière. Et dans l’industrie, le nombre de pigments réellement utilisés est assez limité ce qui est une bonne nouvelle, car avec notre technologie, nous pouvons en produire une grande partie.
Nous avons donc développé une trichromie complète un jaune, un rouge et un bleu utilisable dans les encres, les peintures et les polymères. Ces pigments sont aujourd’hui produits à l’échelle du kilogramme sur notre pilote à Roussillon et devraient atteindre les volumes industriels nécessaires pour entrer sur le marché dans les prochaines années.
Capsule Expert #3
Timothée : On arrive un peu à la fin de l’interview. Avant de te poser deux ou trois dernières questions, j’avais envie qu’on prenne un petit moment d’inspiration avec toi, Sibylle, parce que je suis toujours curieux de découvrir des marques innovantes pour m’habiller. Là, vous ne le voyez pas, mais j’ai sorti mon costume le plus coloré de toute ma garde-robe.
Si on veut déjà passer à l’action aujourd’hui, Sibylle, comment fait-on pour choisir des marques qui produisent des vêtements de manière…
Sibylle : L’avantage, c’est que dans le secteur du textile, il existe aujourd’hui beaucoup d’outils pour consommer de manière plus responsable. Parmi les incontournables, il y a d’abord la marketplace WeDressFair, une plateforme française qui ne référence que des marques engagées. Si une marque y est présente, vous pouvez être assez sûr qu’elle est certifiée et que ses matières sont responsables et produites de manière éthique.
Une autre solution, c’est l’application Clear Fashion, un peu le “Yuka de la mode”. Elle permet d’évaluer un vêtement selon quatre critères : l’environnement, la santé, les conditions humaines et le respect des animaux. Il suffit de scanner l’étiquette de son vêtement pour connaître sa note.
Il existe aussi quelques réflexes utiles. Par exemple, si vous achetez un jean ou un tee-shirt en coton, vérifiez si le coton est certifié GOTS, l’une des certifications les plus exigeantes. On peut aussi chercher le label Ökotex, qui garantit l’absence de substances nocives.
Le sourcing du pigment ou du colorant fait partie des critères pris en compte dans certaines de ces labellisations, mais il n’existe pas encore de label spécifique dédié à la teinture.
{{cta-1}}
On s’inspire et on partage
Timothée : Guillaume, est-ce que tu aurais un petit conseil à partager avec nos auditeurs pour bien choisir leurs vêtements ? Ou peut-être une marque qui t’inspire particulièrement ? Un “client rêvé” avec lequel tu aimerais collaborer ?
Guillaume : Les conseils que tu donnes sont excellents. En effet, il existe déjà pas mal de standards et de labels, et Ökotex comme GOTS sont vraiment des références. Nous-mêmes, chez Pili, nous regardons actuellement comment nous intégrer à ces démarches, puisqu’il faut s’enregistrer pour apparaître dans ces certifications.
Si on veut soutenir une industrie textile en France, l’idéal est aussi de se tourner vers les marques françaises qui font aujourd’hui des choses vraiment intéressantes. Il y a 15 ou 20 ans, ce type de marques qui communiquent autant sur leur fabrication locale n’existait quasiment pas. Profitons-en.
Et en plus, je trouve que leurs produits restent abordables, ce qui en fait une très bonne manière de soutenir l’industrie textile française.
Le podcast est accessible sur les plateformes suivantes : Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music...
Installez-vous, on vous emmène dans les coulisses d’une révolution plastique !






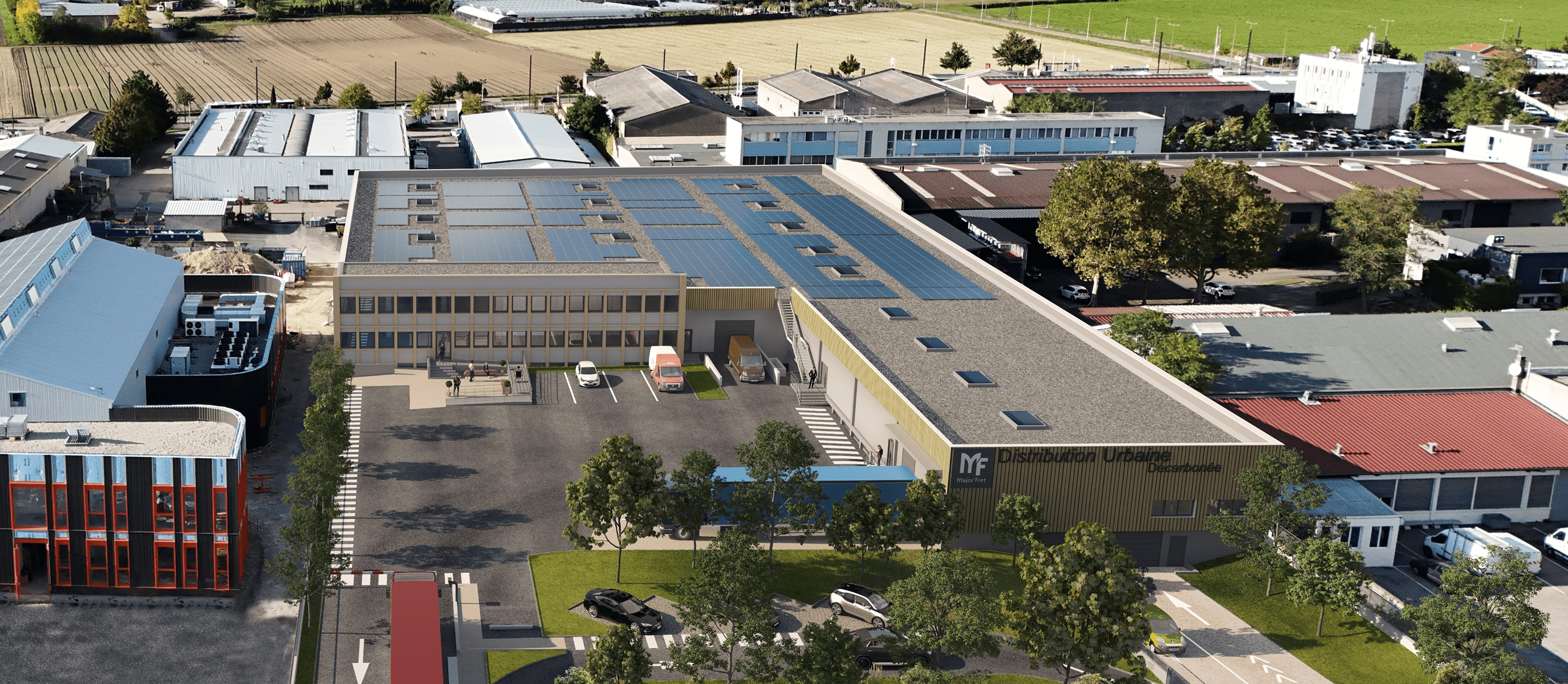









.webp)






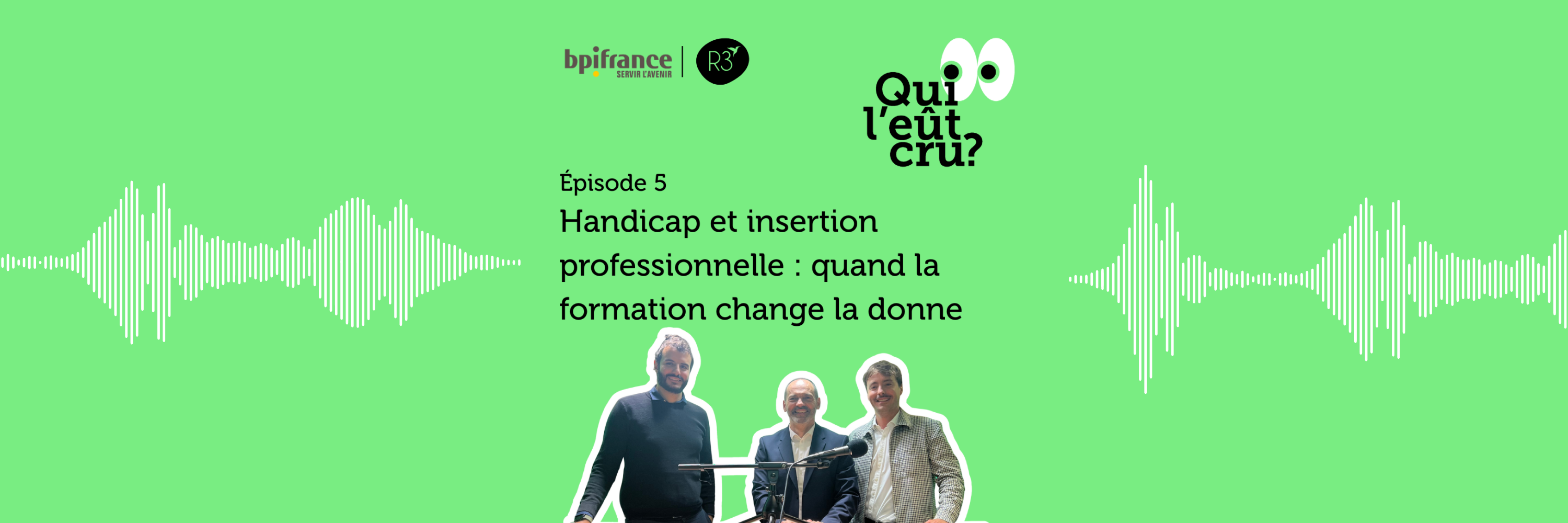

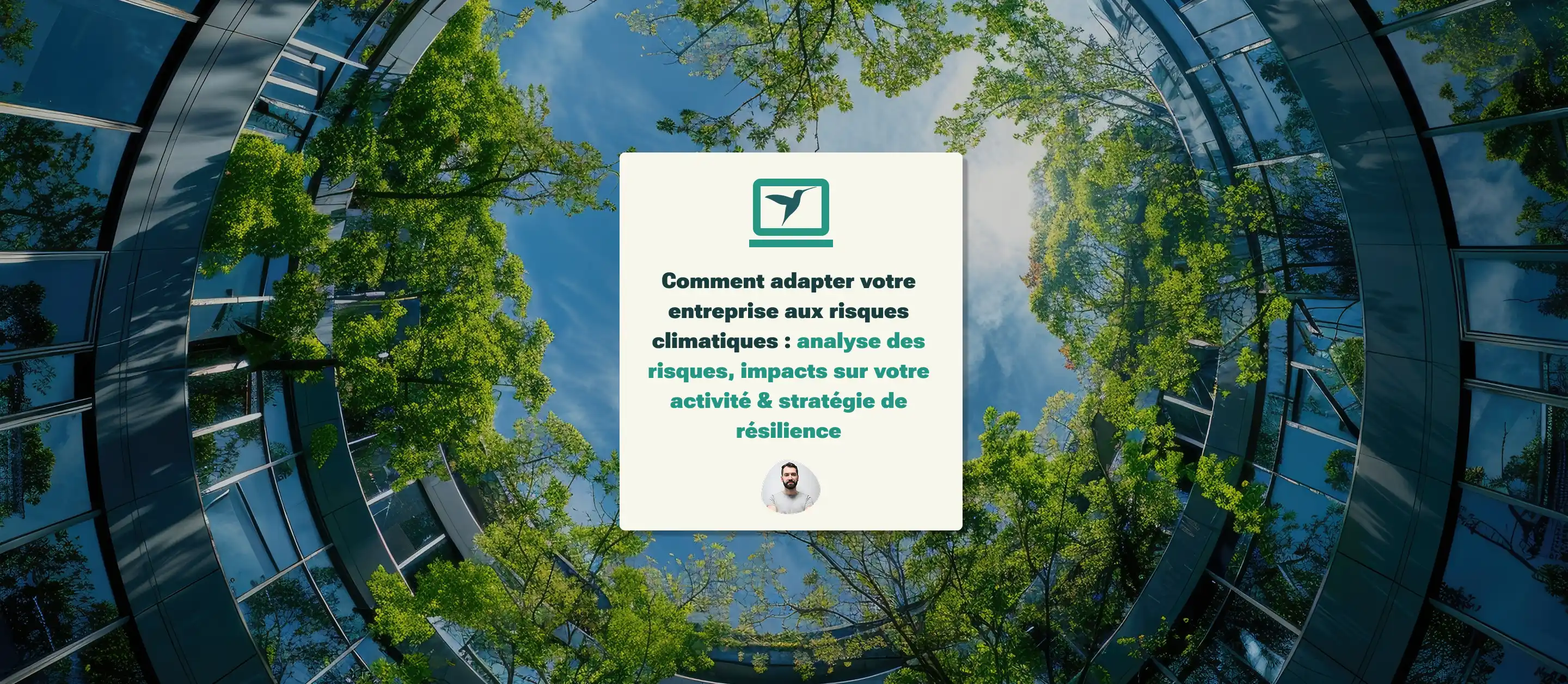
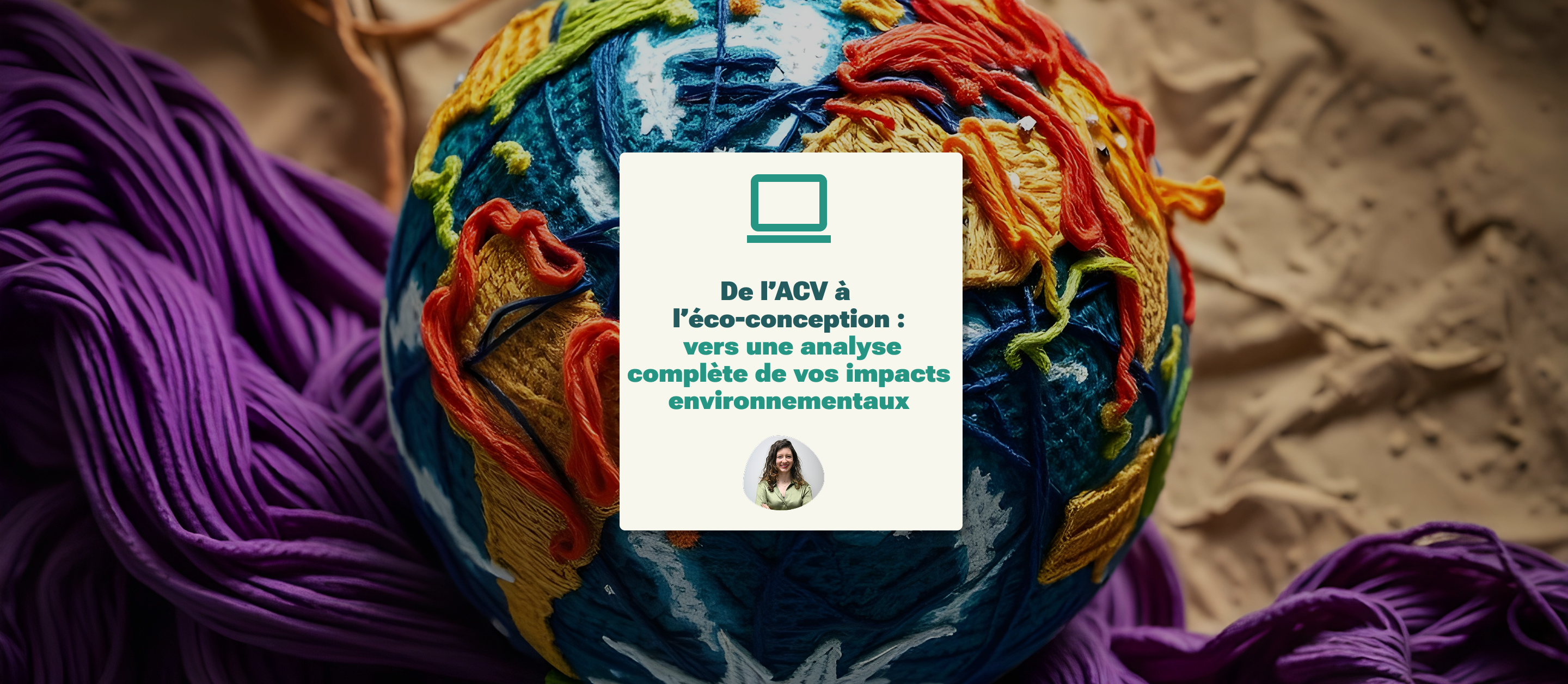


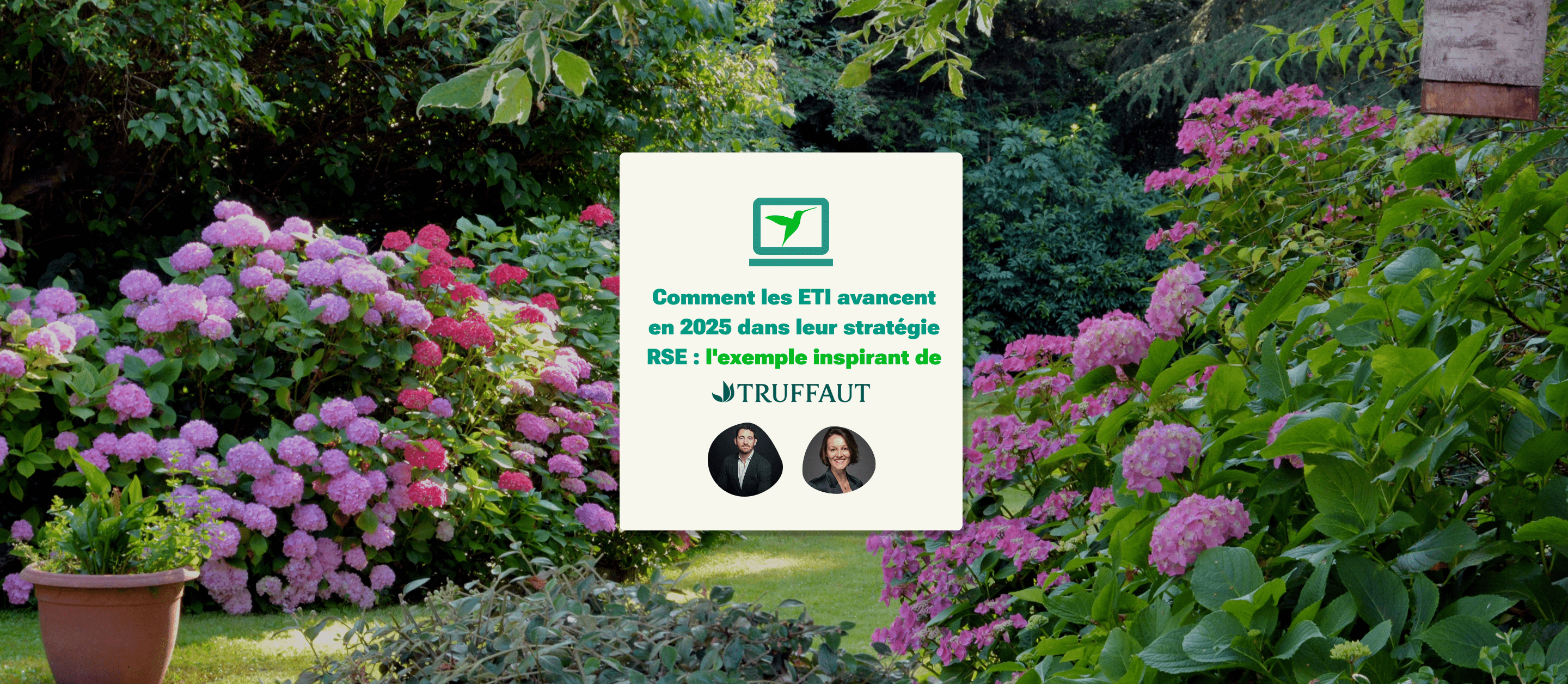


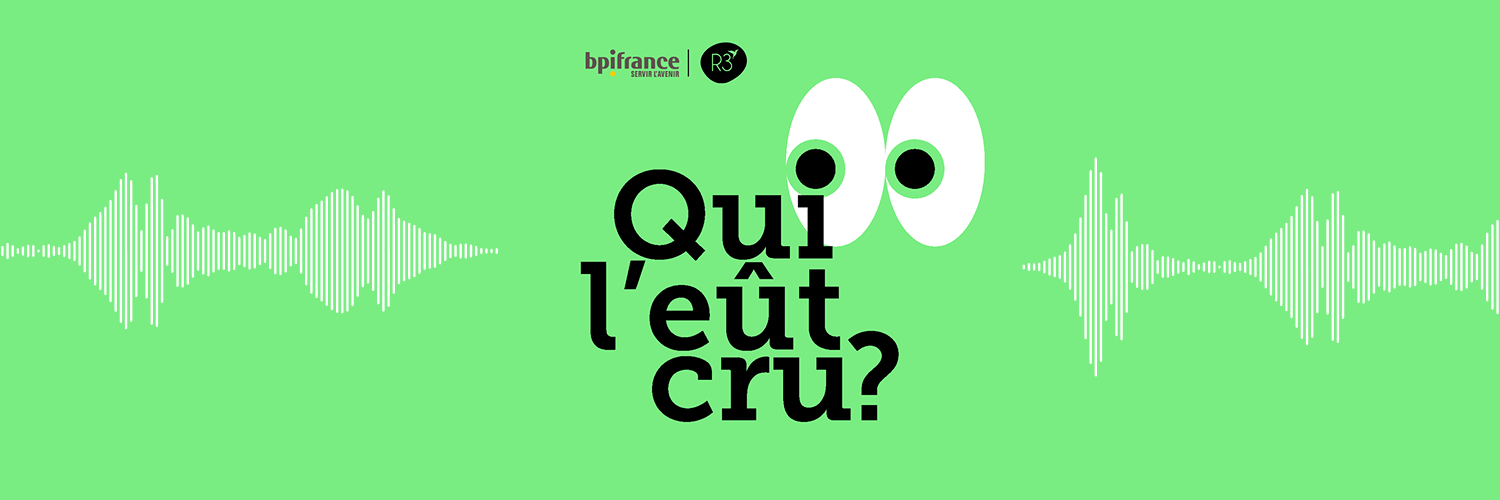














.webp)

























.jpg)

























